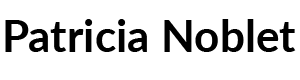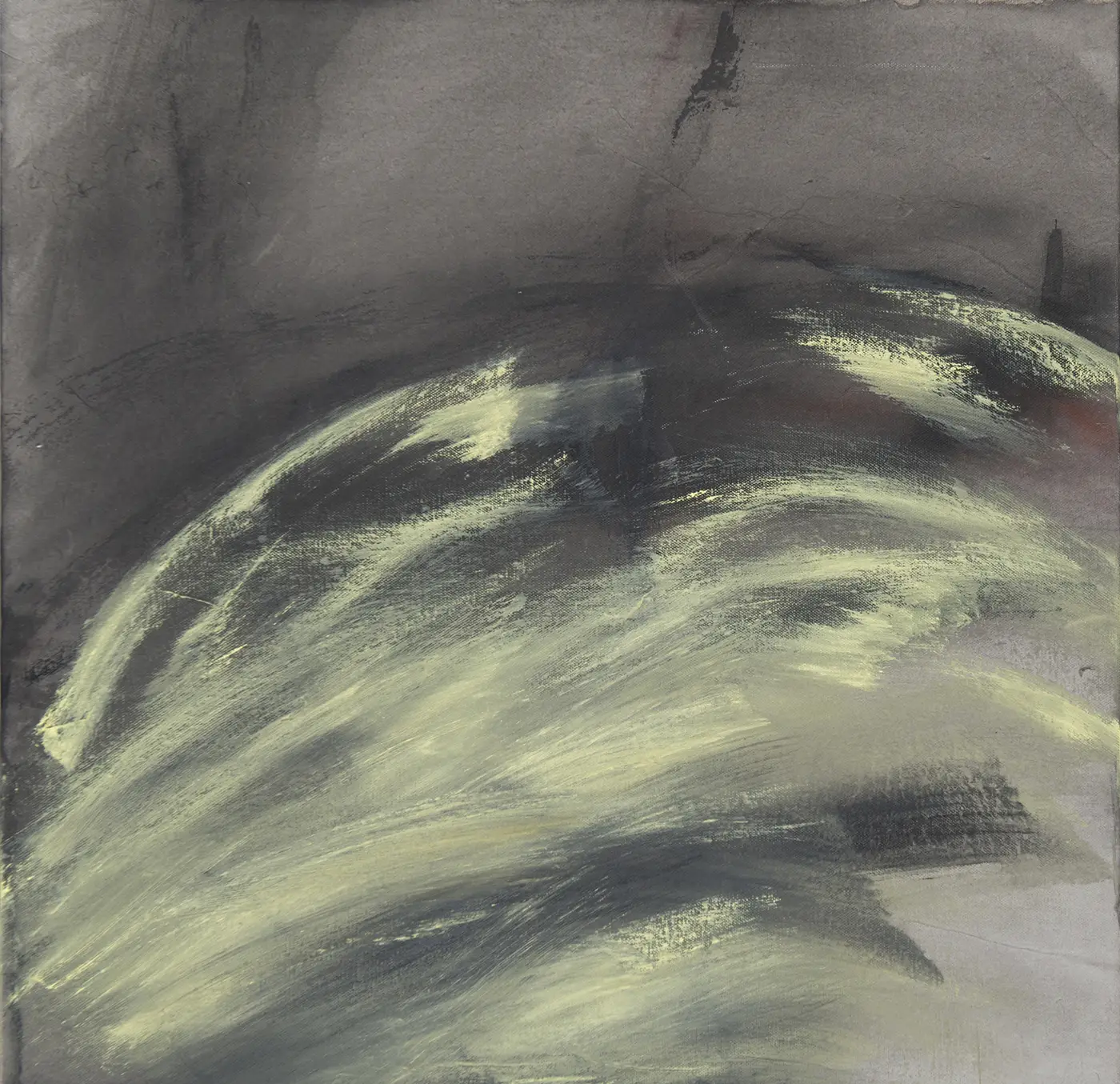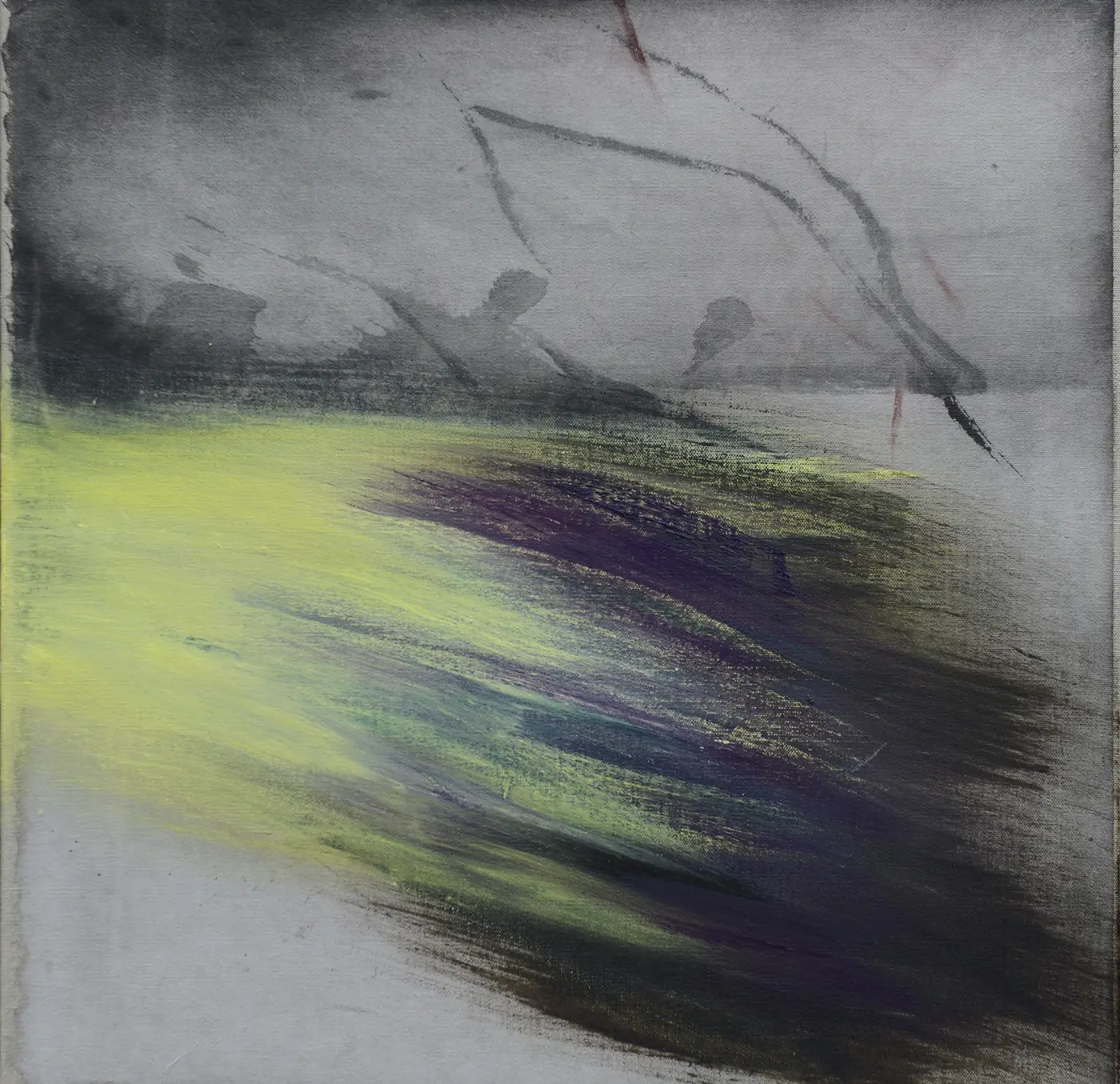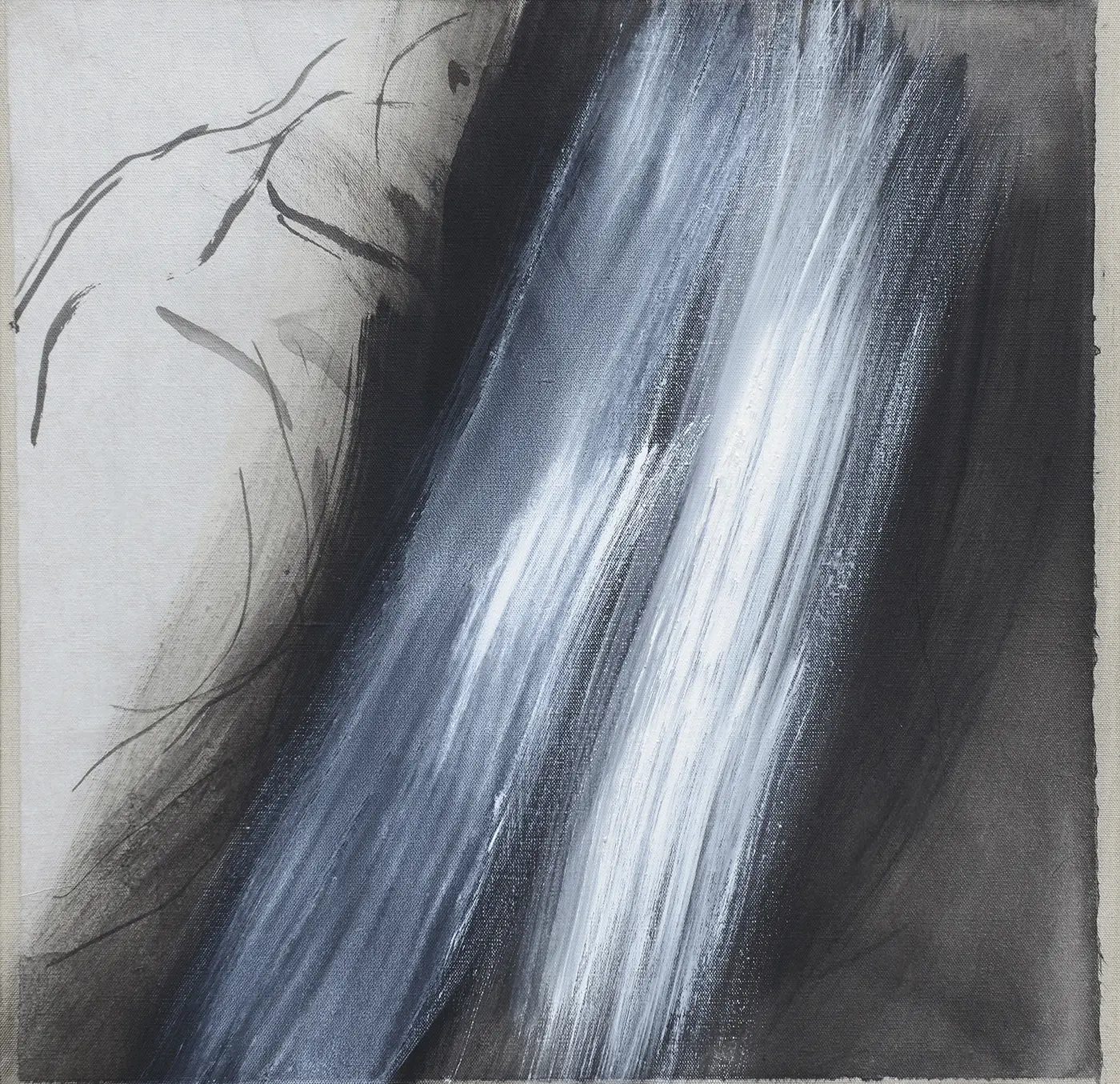Qu’on pense à Turner, pour la grâce – pour le ciel – ou à certains Twombly, pour
la griffure, qu’on pense à la lumière des cavernes ornées, à des feux antiques, ou
à la morsure d’un bras de Loire qui gagne sur le sable, on est toujours loin du
compte.
Car il s’agit là d’une écriture, d’un langage qui se forge, infiniment soupesé et
libre, d’une grammaire des mouvements et des tremblements, dont l’épicentre
serait la Nature.
La Nature – je n’ose même pas dire le motif- patricia noblet y revient comme il
faut en revenir toujours au modèle, en l’aquarellant sur des dizaines de carnets,
déclinés en autant de dessins, qui ont le souffle et la précision elliptique des
idéogrammes chinois.
J’ai vu chez elle de ses dessins de Méditerranée, des dessins bleus, déjà
composés, saisis à partir d’une barque, et qu’elle compulse comme une écolière .
« Je les regarde, je les apprends par coeur – me dit-elle – comme si j’avais peur
d’oublier ce que c’est »
C’est là une confession d’enfant.
patricia noblet possède l’étrange fraicheur d’une artiste qui ne sait pas pourquoi
elle peint, et qui cherche, avec la même ascèse depuis 35 ans, quelque chose
entre la disparition d’un souvenir et la poursuite bouleversée d’une partition du
vivant.
Quelque chose en somme d’extrèmement périlleux, de constamment habité par
une exhorbitante quête de simplicité, mais qu’elle envisage avec une grande
liberté de ton.
C’est là son privilège. Et sa folie.
Il n’y a pas ici de mélodrame qui se joue ou qui se dénoue. Il n’y a pas de scène
à se repasser la mire de la disparition de l’art.
C’est un travail de restitution dans lequel il y a, je crois, une grande jubilation, et
aussi un risque immense comme un rêve, à réconcilier la lumière de l’âme avec
celle du matin.
Il y a la constance du jardinier et une discipline par essence joyeuse – comme la
connaissance, et comme l’apprentissage – il y a le meilleur d’une vie illuminée
par la peinture.
Remy Pastor novembre 2005